Publié Le 10.07.2016 à 13h31
Olivier Py, directeur du Festival d’Avignon : « Je ne voulais que des aventures extrêmes : le théâtre, la mort, le cloître »
La soixante-dixième édition du festival de théâtre et de spectacle vivant se tient jusqu’au 24 juillet dans la cité des Papes.
Auteur, metteur en scène, acteur, Olivier Py est directeur du Festival d’Avignon, dont la soixante-dixième édition se tient jusqu’au 24 juillet dans la cité des Papes.
Je ne serais pas arrivé là si…
… si ma mère ne m’avait pas appris une chose fondamentale : « Le travail paie ». Elle me le disait toujours. Elle m’a donné un goût immodéré pour le travail, avec un peu de pression aussi ! Parce qu’il fallait toujours que je sois le meilleur partout, tout le temps.
la suite après cette publicité
Je tiens de ma mère un sens pratique extraordinaire, d’organisation, de pragmatisme. Toute ma stabilité psychologique vient de ce qu’elle, et mes grands-mères, m’ont donné comme amour. Tout ce qui est, en moi, subversif et dangereux vient de mon père…
Et je ne serais pas arrivé là si je n’avais pas eu une professeure de français merveilleuse : mademoiselle Barrel, en classe de quatrième. Elle avait invité dans notre collège tout pourri la Compagnie lyonnaise des Huit-Saveurs. Pendant une semaine, les artistes ont fait un atelier de théâtre autour de Candide. Cela a changé ma vie. L’année suivante, ils sont revenus et m’ont proposé un petit rôle.
Pourquoi cela a-t-il changé votre vie ? Que s’est-il passé au contact de ces artistes ?
J’étais déjà passionné d’art et de littérature, alors que mon milieu social ne m’y prédisposait pas. Mais, en travaillant avec des comédiens dans ce collège, les choses sont devenues possibles. Je trouvais un lieu d’intense jouissance. Au fond, j’apprenais à jouir. Je découvrais tout simplement la vie de l’esprit.
Sans cela, j’aurais mis plus de temps à comprendre que c’était ma place. Ensuite, j’ai commencé à lire tout ce qu’il y avait dans la bibliothèque familiale : Camus d’abord, puis Bazin, Mauriac, tout. Et je suis devenu graphomane. A 17 ans, j’écrivais tous les jours. J’en ai des cartons.
Etes-vous encore en contact avec votre ancienne professeure de français ?
Je la revois au Festival. Et je lui rends toujours hommage. J’essaie à mon tour de faire comme elle, parce que je sais que cela sauve des existences. Dès que je suis arrivé à Avignon, j’ai repéré le collège le plus dur. La première fois que j’y suis allé, quand j’en suis ressorti, j’avais les larmes aux yeux.
Est-il vrai que vos parents vous ont dit : « Homosexuel si tu veux, artiste si tu veux, mais curé, non ! » ?
Pas curé, moine !
Vous avez eu la tentation d’être moine ?
Il y a d’abord eu mon coming out à 16 ans auprès de la famille et de l’école. Dans les années 1980, ce n’était pas très commun. A cette époque, j’hésitais entre les vocations religieuse, monacale, et artistique. Je n’ai jamais pensé être curé, mais vivre – comme le dit Bernanos – une aventure spirituelle héroïque, de silence, de prières, de rencontre avec la joie, j’en ai rêvé très fortement.
Je pourrais dire que j’en rêve encore. Quand j’étais jeune homme, je voulais à la fois dévorer le monde et en même temps m’en retirer. Je crois que c’est toujours le cas. Je transporte avec moi un cloître discret.
Mais vos parents étaient des laïcards…
Ah oui, très laïcards. Mon idée ne leur plaisait pas du tout. Artiste, pédé, de gauche, ça allait encore, mais moine, non. Cette dimension religieuse les surprenait. Mais à 20 ans j’étais infernal.
Infernal ?
Je ne voulais que des aventures extrêmes : le théâtre, la mort, le cloître. J’étais très tenté par la mort entre 15 et 20 ans. J’étais plus que tourmenté, j’étais scarificateur, au bord du suicide. Je me trimballais quand même à l’école avec un revolver chargé ! J’étais spécial. J’avais mon 22 long rifle, volé à mon père, qui aimait beaucoup les armes.
J’ai toujours vécu avec la souffrance. La souffrance n’empêche pas de rire, de vivre, de travailler beaucoup. Certaines personnes vivent avec cela pour toujours, c’est comme ça.
Que gardez-vous de l’enfant que vous étiez ?
Deux choses : d’abord l’humour. Je rigole encore tout le temps. Ensuite la Méditerranée. J’appartiens à cette mer, mes parents l’ont traversée dans tous les sens. L’histoire de la Méditerranée, c’est une histoire de barque avec des gens qui s’enfuient. Mes parents, expatriés, m’ont beaucoup raconté leur voyage. Et ma grand-mère me racontait comment ces parents sont venus de Naples sur une barque. Je suis profondément un Méditerranéen, parce que l’appartenance nationale me semble dérisoire par rapport au fait d’être un Méditerranéen.
A 20 ans, en 1985, vous venez jouer pour la première fois dans le Festival « off » d’Avignon et vous vous jurez de ne plus y revenir…
Je venais d’échouer à Normale sup, j’avais un chagrin d’amour, je préparais le concours de l’Idhec [l’ancien nom de la Fémis]. C’était la première fois que j’étais engagé professionnellement. Je débarquais, me sentais étranger. Je faisais un remplacement dans une troupe qui jouait L’Ecume des jours. C’était très dur. C’est pour cela que je garde à jamais une admiration pour les gens qui font le « off », collent des affiches, tractent, montent et démontent le décor chaque jour.
Finalement, vous êtes revenu…
Chaque année ! Avignon, c’est un combat. Ce n’est pas un festival de divertissement. J’ai commencé à aimer ce combat. En 1988, j’ai joué dans une pièce de Lenz. Quelques années étaient passées, j’étais entré au Conservatoire et me sentais moins perdu dans ce monde-là. Cela a été magnifique. Je l’ai vécu avec beaucoup de joie.
Vous dites que c’est Shakespeare qui vous a rendu libre…
Shakespeare agrandissait le monde. Le théâtre, c’était toujours une chambre, un salon, avec lui c’était le monde. Il y a un théâtre bourgeois, réaliste, bienséant. Et puis il y en a un autre qui a la folie de représenter le monde. C’est d’abord chez Shakespeare que je l’ai trouvé. Lorsque Jean Vilar a voulu, en Avignon, faire voler en éclats le théâtre bourgeois, il est allé chercher Shakespeare.
« La Servante », en 1995, représente le tournant de votre carrière. Quel souvenir en gardez-vous ?
La Servante, c’est la plus belle semaine de ma vie. Et cela m’a ouvert toutes les portes. J’avais 30 ans. Nous étions 27 acteurs et voulions jouer un spectacle de vingt-quatre heures. Ne jamais s’arrêter, jouer sans fin. C’était l’aventure utopique, une proclamation de la vie spirituelle. Pour nous, c’était de l’art pour l’art. Pas un happening, mais des pièces de théâtre que j’avais écrites et répétées pendant plus de deux ans. Etonnement, le public a suivi. L’étrange alchimie a été de faire un geste héroïque, radical et en même temps un succès populaire. Là, j’ai commencé à comprendre Avignon.
C’est-à-dire ?
L’exigence artistique qui produit du théâtre populaire : c’est ça le miracle, le tour de passe-passe d’Avignon.
Derrière la notion de « théâtre populaire », que mettez-vous ?
Il faut faire attention de ne pas flatter le public dans le sens de l’Audimat. C’est là qu’un pays perd son âme. A Avignon, Jean Vilar n’a jamais flatté le goût du public. Il est parti d’une chose très simple : « Ce en quoi je crois, si j’y crois sincèrement, le public y croira. » Paul Puaux, ancien directeur du Festival d’Avignon, m’avait dit après ma pièce Le Visage d’Orphée : « Les critiques, ce n’est pas la peine de les lire. Le milieu du théâtre n’en attend rien. Tu n’as qu’un seul allié, c’est le public. »
C’était vrai. Pour tous mes spectacles, j’ai toujours été sauvé par le public. Dans la vie, je déteste m’ennuyer, je suis enfantin à ce niveau-là. Mais la bourgeoisie adore s’ennuyer. Elle croit qu’elle pense quand elle s’ennuie et que le rire est vulgaire, qu’il n’est pas un trait de l’esprit.
La même année que « La Servante », vous participez à une grève de la faim pour dénoncer le drame de la Bosnie. C’est le début de vos engagements politiques. D’où ce besoin de vous engager vient-il ?
C’est à cause du sida et parce que je suis catholique. A priori, quand on est catholique, on est censé se battre pour les autres et non, par exemple, défiler pour empêcher les homosexuels d’avoir des droits. Mais d’abord il y a eu le sida : cette nouvelle forme d’engagement associatif qui partait de la société civile (comme Act Up), c’est vraiment ma génération.
Je n’ai jamais pris de carte dans aucun parti. Les discussions néomarxistes de mes camarades de classe m’endormaient, je les trouvais totalement hors sol. J’avais la sensation que la guerre en Bosnie était en train de détruire l’idée même d’Europe et qu’on était face à un nettoyage ethnique qui s’apparentait à un génocide.
Puis j’ai rencontré Susan Sontag. Elle revenait de Sarajevo et me dit : « Je ne comprends pas pourquoi les intellectuels en Europe ne font pas comme à l’époque de la guerre d’Espagne. » Entendre ça a ouvert les vannes et je vivais jour après jour en lien avec Sarajevo.
Ensuite, j’ai rencontré François Tanguy et quelques amis qui créèrent, pendant La Servante, ce qu’on a appelé « La Déclaration d’Avignon » pour briser le sentiment d’impuissance que donnaient les médias. Les grands médias nous informent et en même temps verrouillent le ressort de l’indignation. Je n’accuse personne, mais c’est un fonctionnement mystérieux qui fait que nous sommes coupables et impuissants.
Avez-vous le même sentiment aujourd’hui face à ce qui se déroule en Syrie ?
Bien évidemment. Sur la Syrie, lorsque je dirigeais le Théâtre de l’Odéon, j’avais accueilli – avec Alain Juppé – une conférence de presse des membres la révolution syrienne. On disait que, si on ne les soutenait pas, ce seraient les fondamentalistes qui prendraient le pouvoir… C’est ce qui s’est passé. Mais être interventionniste est quelque chose de complexe dans un héritage de gauche pacifiste.
Comment l’envie d’être directeur de théâtre public vous est-elle venue ?
Ce n’était pas un plan de carrière. Simplement, ma vie rêvée a toujours été d’avoir une chambre dont la fenêtre donnerait sur une scène de théâtre. Je m’en sentais capable.
Cela oblige à une proximité avec le pouvoir politique, les institutions culturelles…
Ce n’est pas la partie la plus douce. La proximité avec les artistes et le public compense largement, en joie, les vicissitudes de la vie de courtisan, car on en est un.
« Courtisan » est vraiment le bon terme ?
Ah oui, c’est vraiment cela, comment toujours. Je publie à la rentrée un roman qui s’appelle Les Parisiens et qui essaie d’expliquer, de raconter comment cela se passe. J’avais envie de faire un roman du XIXe siècle. J’ai voulu retrouver les deux parties de moi : le mystique intraitable et le mondain prêt à tout.
Tout, à Paris, fonctionne par un système de courtisanerie – des amis d’amis, des rivalités personnelles, des intrigues, des dîners en ville, des rumeurs, des réseaux – au point que tout perd son sens. Je crois que c’est très exactement à ça que Jean Vilar a voulu échapper en allant mettre un tréteau dans la cour du Palais des papes [rires].
Rien n’a changé ?
Les sociétés ont des maladies comme les hommes. Cela peut être le populisme, cela peut être aussi le parisianisme, la société des héritiers. En 1984, quand je suis arrivé de province, je ne connaissais personne dans cette ville. Je n’avais aucune idée de ce fonctionnement parisien : la reproduction des élites, l’entre-soi… c’est fascinant à voir. C’est un groupe de pouvoir. Ils tiennent les rênes d’eux-mêmes, de leur microsociété, de leur jeu théâtral à eux, à nous, car j’en fais partie.
Diriger le Festival d’Avignon, c’était un rêve ?
Bien sûr, c’est le rêve de ma vie. Avignon m’a tout donné, a fait de moi ce que j’ai été. Je n’ai pas connu d’amour plus grand que le Festival. La culture, c’est l’avenir. Son rôle est de donner du sens, particulièrement quand il n’y en a pas. L’émotion esthétique est fondamentale. C’est la clé qui ouvre tous les possibles. On regarde le plafond de la chapelle Sixtine et on se dit que notre misérable existence a du sens.
Quel est votre rapport au pouvoir ?
Je n’ai jamais aimé le pouvoir pour le pouvoir. Ma vie, c’est de faire de l’art. Diriger un théâtre ou un festival permet de faire des œuvres d’art, c’est tout. Même en tant que metteur en scène, je ne suis pas du tout un dictateur. Le pouvoir est dangereux et il rend fou. Il faut avoir autour de soi des êtres qui vous jette un seau d’eau froide quand on perd le sens des réalités. J’ai cette chance. Un bon artiste de théâtre doit tendre vers la politique mais tendre seulement. Quelquefois, je suis tombé dedans [rires].
En mars 2014, lors des élections municipales, vous menacez de démissionner si le Front national est élu. Une déclaration qui a suscité des réactions violentes…
Oui, j’ai même reçu des menaces de mort homophobes. Même la gauche a été violente, parce qu’elle n’aime pas quand la société civile lui fait la leçon. Si c’était à refaire, je redirais la même chose. Il me semble que c’est mon rôle. Je ne pouvais pas faire autrement. J’ai aussi appelé à voter Christian Estrosi au second tour des élections régionales. Je n’avais pas du tout envie qu’au bénéfice d’un vote blanc, Marion Maréchal-Le Pen s’empare de cette région. Il faut des générations pour construire une écologie culturelle et il suffit de très peu de temps pour la mettre à bas.
Brexit, montée des populismes et de l’extrême droite, que vous n’avez cessé de combattre… Etes-vous inquiet face à l’avenir ?
J’ai une inquiétude extrême, que je n’ai jamais eue auparavant. Je suis un Européen convaincu et j’ai l’impression de voir l’Europe s’écrouler. Il ne faut pas laisser la politique à des professionnels de la politique, cela n’a aucun sens. Quand le peuple aura compris ça…
Propos recueillis par Sandrine Blanchard
Avignon 2017 : “Les Parisiens” vus par l’outrance et l’insolence d’Olivier Py
Le metteur en scène et patron du Festival d’Avignon adapte son propre roman. 4h30 d’un spectacle où le petit monde culturel de la capitale est dépeint parfois avec naïveté, mais qui est emporté par une belle ivresse de théâtre.
Nous avions aimé ce délirant roman fleuve où les orgies les plus corsées se conjuguent aux intrigues artistico politiques ; où foi, sexe, littérature, pouvoir et œuvres d’art mènent une sarabande à faire se damner Balzac, Nietzsche, Claudel, Gide et Teilhard de Chardin réunis. L’auteur et patron du festival d’Avignon s’affiche chrétien, homosexuel et affamé de reconnaissances, comme de jeux. Ce trublion métaphysique de nos scènes publiques – tantôt insolent dieu Pan tantôt mystique doloriste – aime aussi, surtout, à s’amuser, une fois la cinquantaine venue et l’obtention des postes les plus passionnants…
Sa dernière création (4h30 avec entracte quand même !) est réussie. On a eu chaud, pourtant, après une première partie trop sonore, bruyante, enfiévrée de mots et d’une volonté toute dionysiaque de choquer. Jusqu’à l’indigestion ? Il y a une telle ivresse de théâtre, de faire théâtre et de constamment étonner, façon Cocteau, de donner la joie, qu’il sera beaucoup pardonné à Olivier Py dans ses outrances, son mauvais goût tapageur, ses insolences gamines, son goût du religieux flamboyant.
Qui ose encore, comme lui, poser crânement sur le théâtre le problème du bien et du mal, de la mort ou de l’absence de Dieu, de la liberté et du pouvoir, de la jouissance et du désespoir, de la militance politique et du renoncement, des grandeurs et du turpitudes du politique ? Sur le sol en damier noir et blanc imaginé par le scénographe frère Pierre-André Weitz, au milieu de façades haussmanniennes photographiées en noir et blanc sur de gigantesques praticables et qui vont évoluer, danser sur scène tout au long du spectacle, Olivier Py raconte en une suite de situations extrêmes, du lyrisme le plus échevelé au prosaïsme le plus grossier (public chaste s’abstenir) le parcours d’Aurélien, jeune metteur en scène poète transgressif et ambitieux, beau comme un faune de Debussy. Et qui pourrait lui ressembler…
“La seule vérité c’est la mort”
Aurélien tente de réussir avec frénésie dans le Paris arty d’aujourd’hui, et où les plus cultureux d’entre les spectateurs reconnaîtront telle grande sociétaire de la Comédie-Française, tel ministre, chef d’orchestre, mécène ou grand commis de l’Etat… Amoureux d’un poète beau comme un ange mais torturé par l’abandon du père, la haine de soi et l’obsession de la sainteté, Aurélien se perd et se retrouve de bras en bras. Sans dédaigner la prostitution qu’il pratique comme un des beaux-arts, inventant le concept de « putitude » ou… « droit au théâtre »…
En lettres rouges sur le beau décor de Weitz, cette inscription dans la première partie du spectacle : « Une étoile brille de nuit ». Après l’entracte elle est devenue : « L’Etoile ne dit rien ». Un renoncement ? Surtout pas. Une énergie hystérique baigne l’infernale, improbable et métaphysique représentation qui s’achèvera sur un air poignant du Tannhauser de Wagner, tandis que tomberont régulièrement des cintres de crépusculaires et gigantesques scènes de crucifixion ou d’enfer peintes par Le Tintoret…
Souvent accompagnés par le piano droit juste devant la scène, les comédiens (la plupart magnifiques dans leurs audaces, leurs démesure, de Philippe Girard à Mireille Herbstmeyer, de Jean Alibert à Emilien Diard-Detoeuf via Laure Calamy) osent en effet proclamer – voir gueuler – des phrases aussi définitives et exaltées que « la musique est la blessure de Dieu », « la seule vérité c’est la mort », « la souffrance est divine », « je suis celui qui vient » et j’en passe… Un désordre traversé de désirs, de révolutions, de morts et de passion irraisonnée pour un dieu proclamé absent lie et délie ainsi l’écriture comme en transe. Et le petit monde parisien qu’Olivier Py prétend – naïvement ? – observer avec ses compromissions, ses lâchetés, ses vanités n’est pas le plus fascinant. Plutôt la rage vitale et la tragique lucidité d’Aurélien-Olivier, duo pourtant moins développé à la scène que dans le roman…
Peu importe alors que le poète Py s’enivre de mots (parfois boursouflés), de rédemption et de foi en vrac avec un très sexy frisson sacré. Pour les quelques scènes que cet obsédé de la séparation, hanté par la personne du père – divin ou trop humain – ose écrire et faire dire sur l’amour, la foi, le doute et l’espérance, Les Parisiens méritent méditation. Théâtrale et spirituelle.
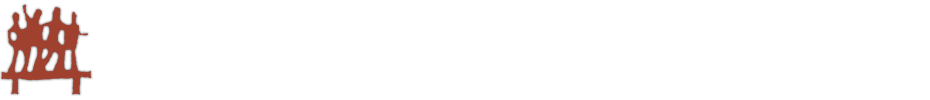




















 Découvrez la chaîne youtube du Théâtre des Ateliers.
Découvrez la chaîne youtube du Théâtre des Ateliers.